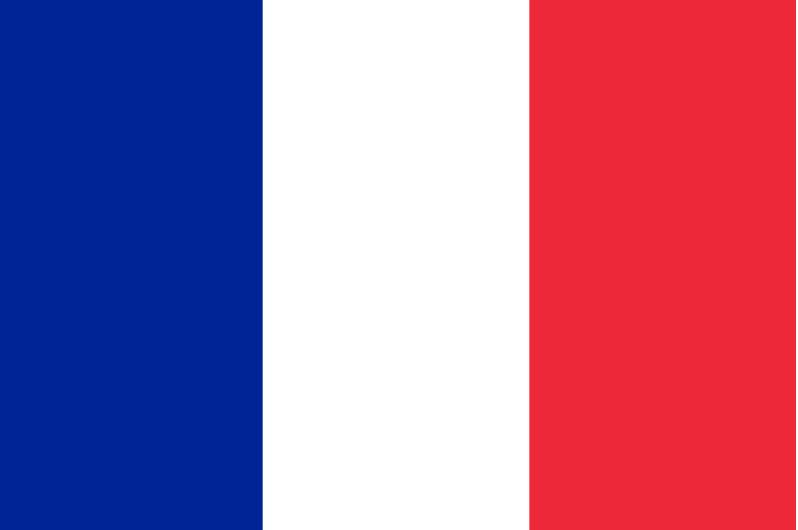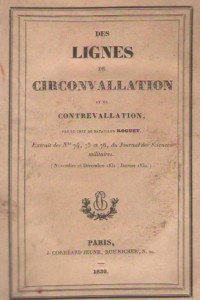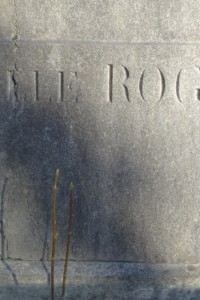François Roguet nait le 12 novembre 1770, à Toulouse (Haute-Garonne). Le 3 mai 1789, il s’engage, à dix-neuf ans, dans le régiment de Guyenne. En 1792, il fait la campagne à l’armée du Var, comme adjudant dans le 1er bataillon de la Haute-Garonne. Il se distingue à Nice et devient, en 1793, adjudant-major capitaine.
Ensuite, il rentre dans la 21e demi-brigade de ligne, où on le charge, en qualité d’adjudant-major, de la discipline et de l’instruction. Il est blessé à Savone en juin 1795.
Il devient chef de bataillon sur le champ de bataille, puis il passe à la 33e, dont il commande le 1er bataillon à Rivoli. En 1799, l’armée d’Italie se révolte et ne veut plus reconnaître l’autorité du général en chef. Seul, le commandant Roguet sait conserver à Mantoue son bataillon dans le poste qu’il doit occuper.
À la bataille de Vérone, le chef de bataillon Roguet marche sur le village de Sainte-Lucie, en chasse les Autrichiens et s’y maintient. Mais il est blessé grièvement d’un coup de feu à la jambe. À l’époque des insurrections des vallées d’Oneille et de Tanaro, c’est lui qui disperse les révoltés. Il fait prisonnier le chef des insurgés et son état-major et rétablit les communications avec Gênes, l’armée et la France. Puis il rejoint, près de Ceva, le général Moreau, qui le nomme, sur le champ de bataille, chef de brigade de la 33e demi-brigade.
Nommé général de brigade, en 1803, il commande au camp de Boulogne les 69e et 76e d’infanterie. Puis il sert en Allemagne en 1805. La brigade Roguet se distingue à Elchingen ; elle enlève le fort de Scharnitz, et ouvre ainsi la route d’Innsbruck.
Le général Roguet déploie aussi sa valeur à Iéna. Le 5 juin 1807, il forme l’arrière-garde et résiste à la garde russe et à une artillerie formidable. Mais son cheval est tué sous lui et une balle lui traverse le pied. Il reste sur le champ de bataille et on le fait prisonnier.
Rentré en France après la paix de Tilsitt sans être encore guéri de sa blessure, il commande l’infanterie de la garnison de Paris. Envoyé dans l’île de Cadsan, il y établit un tel système de défense, que les Anglais doivent s’éloigner et respecter Flessingue. En 1808, il se distingue aux sièges de Bilbao et de Santander, et il passe colonel au 2e des chasseurs à pied de la Garde impériale, avec lesquels il se trouve à Essling et à Wagram.
Ensuite, il conduit en Espagne, les tirailleurs et voltigeurs de la garde nouvellement formés. Il fait à leur tête les campagnes de 1809, 1810 et 1811. Il passe général de division le 24 juin 1811, et commandant du 6e gouvernement d’Espagne. En mars 1812, il se rend avec sa division de la Garde sur le Niémen. Arrivé le 4 juillet à Vilnius, il fait la campagne de Russie.
Pendant la retraite, sa division fait des prodiges : le 14 décembre, au-dessus de Smolensk, elle s’ouvre, pendant la nuit, un passage en renversant les forces accumulées de Miloradowisch. Elle protège ainsi la retraite de toute la Garde, se dirigeant sur Krasnoë. Ce choc arrête pendant vingt-quatre heures le mouvement de l’armée russe et donne le temps au prince Eugène de Beauharnais de rejoindre Napoléon à Krasnoë.
À la bataille de Dresde, il commande 14 bataillons de conscrits à peine équipés, que Napoléon compare, ce jour même, à ses vieux soldats. À Leipzig, il culbute un corps d’Autrichiens et soutient les charges de la cavalerie réunie des gardes prussienne et russe. Dans la retraite sur le Rhin, il forme l’arrière-garde et se distingue à la bataille de Hanau.
Il prend, à Bruxelles, le commandement des troupes de la Garde. Il commence le 20 décembre le bombardement de Bréda, mais sans succès. Le 30 mars 1814, au combat de Courtrai, il renverse et détruit un corps de Saxons. Après l’abdication, le général Roguet fait à Lille sa soumission au nouvel ordre de choses.
Il garde sa position dans la Garde, devenue Garde royale, et la remet presque intacte à Napoléon en 1815. Il combat avec elle à Fleurus et à Waterloo. De retour à Paris, il signe, avec dix-huit de ses frères d’armes, une énergique protestation contre les Bourbons. On le met donc en disponibilité. Après la Révolution de 1830, on l’appelle au commandement de l’infanterie de la 1re division. Puis il commande la 7e division militaire.
Pendant son séjour à Lyon, il réprime la révolte des Canuts de novembre 1831, avec une grande rigueur. On lui reproche cependant d’avoir fait sortir les troupes de la ville, et d’avoir ainsi pactisé avec la révolte. Cette circonstance nuit au général Roguet dans l’esprit de l’armée et du peuple, et le met mal avec la cour.
Le comte Roguet meurt le 7 décembre 1846, à Paris, à l’âge de 75 ans. Il est le père du général Christophe Michel Roguet, aide-de-camp de Napoléon III.
Titres : Baron de l’Empire (1807), Comte de l’Empire (28 novembre 1813), Pair de France (19 novembre 1831). Distinctions : chevalier (11 décembre 1803), commandeur (14 juin 1804), grand-officier (23 aout 1814), grand-croix (21 mars 1831) de la Légion d’honneur, chevalier de l’Ordre de la Couronne de Fer (1807), grand-croix de la Réunion (1813), grand-croix de l’Ordre de Hesse (1813), croix de Saint-Louis (8 juillet 1814).
Hommages : Une place lui est dédiée dans sa ville natale de Toulouse, la Place Roguet, dans le quartier Saint-Cyprien. Son nom figure sur l’arc de triomphe de l’Etoile, côté Sud.
Sources : Base Léonore (Légion d’honneur) ; Wikipedia. Date de création : 2009-08-21.